Avec l'auteur et critique de cinéma, François Bégaudeau, nous avons parlé d’eux. De deux films qui, chacun à sa manière, déplacent le cinéma vers ses bords, là où le récit se fragilise et où l’image cherche à tenir seule, sans la béquille rassurante de la dramaturgie. Sirat, quatrième film d’Oliver Laxe, s’ouvre sur un désert : mais ce désert n’est pas décor, ni simple motif d’exotisme. Il est matière, bruit, rugosité, lumière crue, espace à la fois d’utopie et de désertion. Dans la poussière marocaine, une communauté de ravers, figures réelles filmées sous leur propre nom, bâtit son mur de son comme on élève un totem. L’enceinte devient fétiche, dieu carré d’où émane la pulsation techno, dont la scansion répétitive rejoint les rituels de la transe religieuse. Au commencement était la musique, et c’est d’elle que le film tire sa puissance, sa ferveur, son énergie mystique.Et puis survient l’accident, imprévisible, brutal : l’enfant meurt. Ce fils que l’on avait accompagné, que l’on croyait protégé par l’utopie communautaire, disparaît d’un coup, avalé par le précipice. Rarement le cinéma contemporain ose une telle déflagration : non pas le twist attendu, mais une irruption de tragédie qui renverse tout, et laisse le spectateur suffoqué. Le récit bifurque, se déporte, déserte ses propres bases. Laxe avait jusque-là filmé la légèreté, la camaraderie, les gestes triviaux et la danse en plein jour ; le voilà contraint d’affronter la mort, et d’y trouver paradoxalement un passage vers la vie. Son film s’allège de tout passé, ne s’embarrasse pas d’explications psychologiques : il filme le présent, rien que le présent, les corps en mouvement, les camions qui roulent, les pierres qui pèsent, la poussière qui crisse. Une manière de cinéma presque prosaïque, et donc libérée.À l’opposé, Christian Petzold, dans Miroirs n°3, filme au contraire l’écrasement du présent par un passé qui sature chaque plan. Là où Laxe déserte l’histoire pour trouver l’air du présent, Petzold enserre ses personnages dans le poids invisible d’une énigme jamais résolue : un suicide dont on ne saura rien, une maison qui retient les fantômes, des visages marqués d’un deuil opaque. Le film n’éclaire rien, mais persiste à habiter la gravité. Chez Laxe, la route s’ouvre en fuite, en bifurcation, en fraternité élective. Chez Petzold, elle se ferme en huis clos, en enfermement mélancolique.Ce premier épisode de "Tout va bien" confronte deux gestes, deux manières d’habiter le cinéma aujourd’hui. L’un cherche la légèreté dans le désert, l’autre la pesanteur dans la mémoire. Deux films qui ne se répondent pas tant par leurs thèmes que par leur rapport au temps : le présent pur d’un côté, l’éternel retour du passé de l’autre. C’est là, peut-être, que le cinéma continue de se jouer — dans cette tension entre l’oubli et la mémoire, la fuite et l’ancrage, le vertige de la route et la mélancolie des murs.
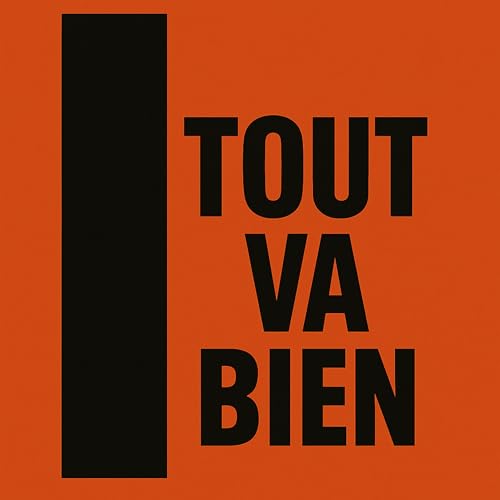 Oct 6 20252 hrs and 30 mins
Oct 6 20252 hrs and 30 mins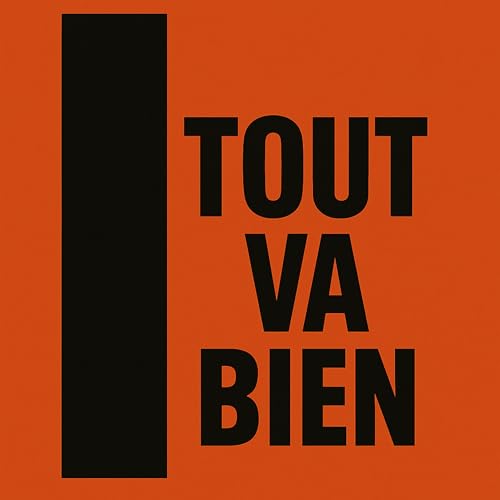 2 hrs and 24 mins
2 hrs and 24 mins

